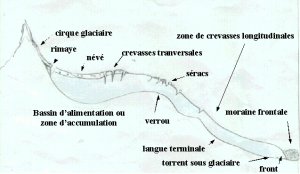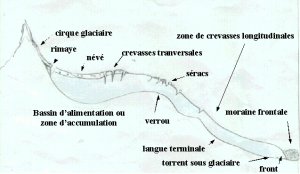La Barre des Ecrins (4102m)
 Les séracs sur la face nord des Ecrins
Les séracs sur la face nord des Ecrins
 Une avalanche est descendue jusqu'au bassin
d'alimentation au bas de la grande pente
Une avalanche est descendue jusqu'au bassin
d'alimentation au bas de la grande pente
 Sous la paroi rocheuse sommitale : la
rimaye
Sous la paroi rocheuse sommitale : la
rimaye
 La langue glaciaire encore recouverte de
neige
La langue glaciaire encore recouverte de
neige
 Les premières crevasses transversales
Les premières crevasses transversales
 Début des séracs
Début des séracs
 La chute des séracs à la hauteur
du refuge du Glacier Blanc; la couleur bleue indique que des
séracs viennent de se détacher
La chute des séracs à la hauteur
du refuge du Glacier Blanc; la couleur bleue indique que des
séracs viennent de se détacher
|
LE GLACIER BLANC
Le Glacier Blanc est le plus grand glacier du
massif de l'Oisans en plein c�ur du Parc National des Ecrins
. Les glaciers de ce massif couvrent 120 km², alors
qu'en France 800 glaciers couvrent 440 km² dont 400
km² dans les Alpes et le reste dans les
Pyrénées. 3200 km² de glaciers couvrent
l'ensemble du massif alpin .
Le Glacier Blanc prend naissance sur la face
nord de la Barre des Ecrins (4102m) et descend sur
près de 7 km jusqu'en dessous du refuge du Glacier
Blanc vers 2200 m. En haute montagne au-dessus de 2700 m il
pleut très rarement et les précipitations ne
tombent que sous forme de neige. Sur ces pentes très
raides, la neige qui ne fond pas, glisse et s'accumule sur
les parties plus plates et se transforme . La neige passe de
son état naturel à celui de névé
(les cristaux se transforment en granulés remplis de
bulles d'air). Puis sous l'action du poids des diverses
couches et de l'eau de fonte de surface s'infiltrant dans
les couches plus profondes, l'air est chassé et les
cristaux se soudent pour former des blocs de glace de plus
en plus gros et de plus en plus bleu. C'est ce qui se passe
au pied de la grande pente de la Barre des Ecrins en face du
refuge Caron. Là , le glacier atteint une
épaisseur de 200 mètres.
Sur cette pente on peut observer de gros blocs
de neige et de glace qui s'écroulent en avalanches et
vont alimenter le plateau en contre bas.
Au pied de la paroi rocheuse sommitale on
remarque une grande crevasse : c'est la rimaye. C'est la
séparation entre la zone où la neige ne fond
jamais et la zone où la neige commence à
fondre en été. Cette crevasse pose quelquefois
des problèmes aux alpinistes qui veulent la franchir
pour gagner le sommet.
Après le refuge Caron, la neige fond
totalement en été et laisse apparaître
la glace vive et le glacier se resserre pour former une
langue glaciaire. Cette langue glaciaire devient
tourmentée et entrecoupée de crevasses. La
glace se fissure. En effet le glacier n'est pas inerte, il
avance, entraîné par son propre poids. La
vitesse du glacier n'est pas régulière :
à la sortie du bassin d'alimentation elle est de 350
m par an alors que vers la langue terminale elle n'est plus
que de 50 m par an .
En face du refuge du Glacier Blanc, nous
observons des amoncellements de glace . Ce sont les
séracs ; si la glace est légèrement
souple et épouse les reliefs doux, son
élasticité a une limite et lorsque la pente
change brusquement elle va se casser et former
d'énormes crevasses. D'autre part si le fond est
bombé de grandes crevasses se forment dans le sens du
glacier, ce sont les crevasses longitudinales. Les bords du
glacier sont freinés par les parois de la montagne
alors que son milieu va continuer à descendre
à une vitesse supérieure, des crevasses vont
partir des bords, ce sont les crevasses marginales. Lorsque
la pente change il se forme des grandes transversales qui
traversent le glacier.
Cette avancée irrégulière
du glacier peut être observée grâce aux
moraines. Les moraines ce sont ces amoncellement de roches
et de terre que l'on trouve sur le glacier. Ce sont les
roches qui ont été arrachées à
la montagne et qui sont transportées par lui. Celles
qui se trouvent au centre sont repoussées
progressivement vers les bords (le milieu du glacier avance
plus vite que ses bords) et rejoignent les moraines
latérales. Les moraines latérales sont
formées par les roches tombées des parois
bordant la langue glaciaire (voir Mer de Glace).
Devant le front, le glacier dépose les
moraines frontales derrière lesquelles se forment
quelquefois un lac. Ces moraines frontales sont les
témoins du recul des glaciers. Au XIXéme
siècle le Glacier Blanc descendait jusqu'au
Pré de Mme Carle où il rejoignait son voisin
le Glacier Noir. A la place maintenant on trouve des champs
de roches laissées par le glacier où coule le
Gyr , torrent émissaire (torrent sortant du glacier)
.
Ce recul du glacier est dû au fait qu'il
n'y a pas assez de précipitations neigeuses en
altitude , donc le glacier n'est plus assez alimenté
alors que la langue terminale fond normalement sous l'action
de la chaleur.
Sur le glacier coulent de véritables
torrents : le glacier fond aussi en surface. Il se forme ce
qu'on appelle des bédières qui s'infiltrent
dans les profondeurs du glacier et creusent un gouffre : un
moulin (voir Mer de Glace). Cette eau coule au fond du
glacier et forme un torrent sous glaciaire qui ressort au
front du glacier et à sa sortie il devient un torrent
émissaire.
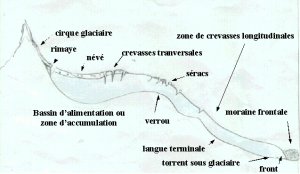
|